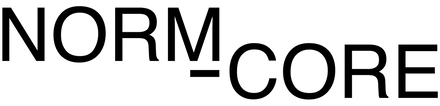Dans l’ère post-pandémie, le mot « mode » était presque synonyme de micro-tendances. Véritable épidémie stylistique, elles ont inondé l’imaginaire collectif pendant près de cinq ans, dictant aux jeunes générations ce qu’il fallait porter pour rester dans le coup. Mais ce cool-là n’était qu’une façade : la plupart de ces tendances express recyclaient des codes de sous-cultures pour les transformer en produits de masse — standardisés, viralisés, et immédiatement imitables. L’idée ? Appartenir à une niche… rendue mainstream par TikTok.
En 2024, cet emballement s’est calmé. Entre pressions économiques croissantes et lassitude face au luxe tapageur, ce qu’on appelle désormais la “fatigue du luxe” a imposé un virage. Un retour vers des repères plus stables, presque fondamentaux. Sous l’effet du recession chic, une tendance transversale s’est dessinée : celle du quiet luxury. Un luxe discret, codé, intemporel.
Mais comment adopter le quiet luxury… sans les moyens du luxe ? Avec des prix qui ne cessent d’exclure, et des marques bien conscientes de cette barrière, une seule option reste : s’habiller simplement, sans prétention. En 2025, selon Dazed, la mode sera sobre, modeste, presque basique.
Un basique qui, pourtant, flirte avec une résurgence inattendue : celle du indie sleaze. Exit le Y2K aseptisé, place à un revival de l’énergie brute des années 2000, façon Glastonbury et rock britannique sous la pluie. La mode de demain ? Un croisement entre minimalisme assumé et nostalgie désinvolte.

Le normcore actuel prend ses distances avec l’avant-garde gothique qui a dominé ces dernières années. Finie l’esthétique Opium, les chevaliers Chrome Hearts, ou les univers sombres, transgressifs et teintés de fétichisme portés par des marques comme Mowalola ou JordanLuca — toutes deux nourries par les sous-cultures de la Gen Z. On assiste à un glissement, du maximalisme obscur vers une forme de normalité presque banale.
Mais attention, sous ses airs fades, ce nouveau minimalisme cache des clins d’œil bien plus pointus : on y retrouve l’élégance froide du Dior Homme d’Hedi Slimane ou la rigueur du Jil Sander du début des années 2000. Une transition stylistique que la vidéaste Mina Le analyse justement dans son essai The Death of Personal Style. Elle y évoque l’évolution de son propre rapport au vêtement, autrefois marqué par l’excentricité, aujourd’hui plus sobre, plus relâché.
Selon elle, ce qu’on qualifie parfois de « mort du style personnel » n’est qu’un réajustement des priorités. Dans les cercles créatifs, et plus encore dans le monde de la mode, on observe un recentrage : au lieu d’investir toute leur énergie dans les looks, beaucoup préfèrent se concentrer sur d’autres formes d’expression artistique. En témoignent les directeurs artistiques eux-mêmes, souvent vêtus de jeans neutres et de pulls sans logo — une sobriété qui en dit long.
La montée en puissance du normcore et d’une mode plus épurée a aussi été accélérée par l’appropriation massive de l’esthétique maximaliste par l’ultra-fast-fashion. Ce phénomène a vidé de leur sens les codes des sous-cultures souvent critiques du capitalisme, en les rendant trop accessibles et banalisés. Comme le soulignait Dazed, là où les club kidsalternatifs d’antan se sont banalisés, les popstars radiophoniques ont, elles, adopté des styles qui détonnent parfois avec leur univers musical. Le changement radical de Damiano David, qui est passé de rockstar en slip en cuir à ambassadeur de la haute couture italienne, en est un parfait exemple.
Dans ce contexte, certaines icônes intemporelles reprennent leur place au premier plan : le retour en force de Jane Birkin, la réinterprétation de Joan Didion, ou encore Alexa Chung, véritable reine de l’indie sleaze. Ces derniers mois, sur les réseaux sociaux, on voit fleurir des looks simples — jeans, chemises, ballerines — qui, loin d’être dépourvus de style, revendiquent subtilement ces références semi-confidentielles.
Le terme normcore ne date pas d’hier : il a été inventé il y a environ dix ans et, comme l’indique une définition d’Urban Dictionary du 31 mars 2014, il décrit une démarche visant à « déconstruire la mode » via une esthétique volontairement neutre et minimaliste. Depuis, beaucoup de choses ont évolué, mais paradoxalement, ce concept revient aujourd’hui sur le devant de la scène.
Cette résurgence s’explique en partie par les inquiétudes d’une génération de plus en plus exposée en ligne, plongée dans un Web2 hyper-individualiste, qui a fini par uniformiser le style. Mais au-delà des cycles habituels des tendances, un autre élément joue : la surveillance implicite des réseaux sociaux, déjà présente au début des années 2010, a poussé nombre de personnes à privilégier des tenues sobres, discrètes, presque anonymes.
Cela ne traduit pas forcément une forme collective de paranoïa, mais dans un monde instable, marqué par l’omniprésence de l’intelligence artificielle et la recrudescence de certaines dérives extrêmes, ne pas trop attirer l’attention a sa logique.
Ainsi, le normcore contemporain, tout comme sa première incarnation, pourrait bien être la stratégie la plus simple — et la moins visible — pour traverser une nouvelle mutation dans l’univers en perpétuelle évolution de la mode.